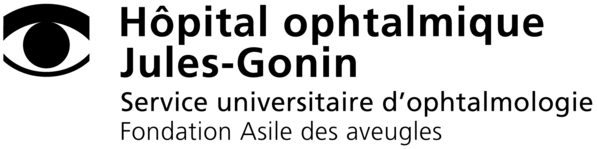Lunettes 3D: au cinéma, mais pas seulement…

Les amateurs d’Avatar, Gravity et autres longs métrages aux décors spectaculaires le savent bien: ils et elles doivent parfois chausser des lunettes 3D pour pouvoir s’immerger dans leur film préféré. Ces lunettes miment en fait la vision naturelle, autrement dit la vue en trois dimensions, de tout ce qui nous entoure.
En effet, lorsque nous sommes devant un objet, nos yeux le voient sous deux angles très légèrement différents. «Il en résulte deux images que notre cerveau superpose et fusionne pour nous permettre de voir le monde en relief. Nous pouvons ainsi apprécier la profondeur, les distances relatives ou encore les angles des éléments qui le composent. C’est ce qu’on appelle la vision stéréoscopique», explique la Prof. Aki Kawasaki, médecin adjointe à l’unité de neuro-ophtalmologie de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Inconfort
Les films en 3D s’inspirent de ce processus en diffusant non pas une, mais deux images de la même scène, captées avec des caméras espacées. Diverses techniques sont ensuite utilisées pour faire en sorte que chacun de nos yeux voie uniquement l’image qui lui est destinée. Certaines lunettes – comme celles, en carton, distribuées avec des vidéos ou des jeux – utilisent des filtres de couleurs complémentaires (rouge et bleu, par exemple). D’autres emploient des verres polarisés et sélectionnent donc les images en fonction de leur polarisation (qui décrit la vibration du champ électrique). D’autres encore, dites «actives», diffusent les deux images avec un petit décalage dans le temps.
Quoi qu’il en soit, «ces dispositifs ne reproduisent pas fidèlement la vision, précise Aki Kawasaki. Dans la réalité, nos yeux changent de position en fonction de l’objet qu’ils regardent, alors que lorsqu’on porte ces lunettes, les deux images constituent un point fixe devant nous». Nos yeux sont donc sans cesse obligés d’accommoder, «ce qui crée parfois de l’inconfort et même une certaine fatigue oculaire, voire, dans de rares cas, des vertiges. Toutefois, ces effets secondaires déplaisants sont transitoires», rassure l’experte.
De la publicité au bloc opératoire
Heureusement, car ces lunettes 3D sont de plus en plus fréquemment utilisées par la télévision, le cinéma, les jeux vidéo, etc. Les images en trois dimensions «sont aussi exploitées par la publicité», constate Aki Kawasaki. Et de citer l’exemple du «chat de Shinjuku»: un gros chat en trois dimensions qui apparaît comme suspendu en l’air en haut d’un immeuble de Tokyo. Bien qu’il semble plus vrai que nature, il ne s’agit en fait que d’un hologramme, «ce qui montre à quel point ce type de technique est avancé», note la spécialiste.
En dehors de leurs aspects ludiques, les lunettes 3D trouvent déjà divers usages dans l’enseignement et l’industrie, mais aussi dans le domaine médical. «Elles participent à la formation des chirurgiens et permettent à des radiologues d’obtenir des reconstructions en trois dimensions de l’anatomie de leurs patients», ajoute la neuro-ophtalmologue. À l’avenir, elles pourraient également aider à la réhabilitation visuelle, en particulier pour des enfants atteints de strabisme ou des personnes souffrant de DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge). Ce n’est qu’un début, car elles trouveront certainement bien d’autres applications.
______
Article repris du site BienVu!

L’intelligence artificielle au service de la recherche

La radiofréquence pour détruire les nodules thyroïdiens