Sclérose en plaques: protéger les neurones

Les symptômes de la sclérose en plaques (SEP), sont multiples: fatigue, troubles moteurs, perte de l’équilibre et de la sensibilité, atteintes visuelles. Les causes de cette maladie inflammatoire du système nerveux central restent aujourd’hui inconnues et les recherches entreprises pour comprendre les mécanismes impliqués ne manquent pas. Notamment celles de l’équipe du Pr Doron Merkler, médecin à l’unité de neuropathologie clinique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et professeur assistant au département de pathologie et immunologie de l’Université de Genève. «Nous nous intéressons essentiellement aux aspects de neuroprotection dans un contexte inflammatoire», explique-t-il.
Leur récente découverte porte sur les mécanismes impliqués dans le processus de développement de la SEP. Dans cette maladie auto-immune, le système immunitaire réagit contre une substance normalement présente dans l’organisme, la gaine de myéline (enveloppe qui recouvre les neurones). Cette structure est attaquée par les cellules immunitaires et les neurones finissent par être détruits. Mais que se passe-t-il au début de la maladie? «Nous avons constaté, dans des souris modèles développant des symptômes proches de la sclérose en plaques, que les cellules autoréactives endommagent les synapses, à savoir les connexions entre les neurones. Ainsi, ces derniers sont d’abord déconnectés, ensuite attaqués, puis altérés de manière irréversible. Comme les neurones fonctionnent en réseau, la déconnexion provoque déjà un dysfonctionnement», répond le Pr Merkler.
Bloquer le processus de transmission
Pour ce faire, les lymphocytes T cytotoxiques, autrement dit les cellules tueuses du système immunitaire, mettent en action une molécule appelée interféron-gamma (IFNy). «En bloquant, chez la souris, cette molécule avec un anticorps qui la neutralise, nous avons empêché une première étape de la neurodégénération», relève le pathologiste. Ces résultats ouvrent des perspectives de thérapies… pour autant que ces découvertes de recherche fondamentale soient confirmées chez l’homme.
Les étapes sont encore longues. Les chercheurs genevois, qui collaborent avec l’Université de Göttingen, espèrent d’abord confirmer que le processus constaté chez la souris est le même chez l’homme. «Pour l’heure, les premières analyses de cerveau humain ont montré des altérations similaires au modèle murin», affirme le responsable du projet. Si le rôle de l’IFNy est confirmé, la prochaine étape sera alors de trouver un inhibiteur de cette molécule applicable chez les personnes souffrant de SEP. «Au final, l’objectif est d’améliorer la protection neuronale vis-à-vis des attaques immunitaires», ajoute le Pr Merkler. Cette approche de neuroprotection pourrait se montrer déterminante pour empêcher le développement de déficits neurologiques irréversibles chez les patients souffrant de sclérose ou d’autres maladies auto-immunes du cerveau.
Deux tiers de femmes
Rappelons que la SEP touche environ une personne sur mille, dont deux tiers de femmes. Elle est diagnostiquée la plupart du temps chez des personnes âgées de 20 à 40 ans. En Suisse, plus de 10 000 personnes sont atteintes, avec un nouveau cas diagnostiqué chaque jour. Pour l’heure, cette maladie ne se guérit pas, le but principal des traitements étant de réduire le nombre de poussées et d’en diminuer la gravité.
__________
Publié dans le magazine Pulsations – Mai-Juin 2014

Sclérose en plaques: un espoir pour les patients atteints d’une forme progressive
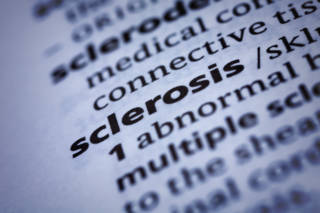
Une infection virale infantile à l’origine de la sclérose en plaques?

Les technologies au service de la neuroréhabilitation
Rencontre avec Caroline Pot, une spécialiste des maladies neuro-inflammatoires
Le point sur la sclérose en plaques
Le virus dʹEpstein Barr impliqué dans la sclérose en plaques

Sclérose en plaques
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune liée à un dérèglement du système immunitaire, qui attaque la gaine de myéline et les fibres nerveuses. Bien que la maladie ait été décrite il y a près de deux siècles, sa cause n’est toujours pas élucidée. Il s’agit d’une maladie complexe et multifactorielle.



